|
Getting your Trinity Audio player ready...
|

L’Académie de Platon après Xénocrate (314–86 avant JC) va continuer de se développer grâce à des figures philosophiques qui peuvent parfois sembler éloignées des conceptions de Platon. Or il existe un lien entre ces différents philosophes au delà de l’institution de l’Académie.
L’Académie, fondée par Platon vers -387, poursuit son activité bien après la mort de son fondateur. Après Xénocrate (décédé en -314), elle entre dans une période de mutation doctrinale profonde, déjà initiée sur le principe par Speusippos et Xénocratys qui avaient remis en causse et fait évoluer la théorie des Formes.1
Après Xénocrate, s’ouvre une période nommé la « Nouvelle Académie » allant du dogmatisme au scepticisme. Nous traitons là d’une phase historique de la philosophie grecque qui constitue une période clé pour comprendre la genèse du scepticisme antique et son impact sur la philosophie romaine.
Avant d’aller plus loin il faut connaître les définitions des courants que l’on applique aux philosophes qui constituent des figures de cette séquence historique :
- Platonisme dogmatique : Une affirmation de conceptions platoniciennes (Idées, Bien, cosmos) comme des vérités.
- Orientation éthique : Chez Polémon (successeur de Xénocrate), un focus sur une vie vertueuse selon la nature, et plus généralement, une priorité donnée à la morale dans l’Hellénisme, face à l’instabilité politique.
- Scepticisme : Une remise en question de toute certitude, initiée par Arcésilas (5e scholarchès), utilisant la dialectique pour suspendre le jugement.
- Scepticisme probabiliste : L’innovation de Carnéade, permettant des choix basés sur la probabilité sans dogmatisme.
- Éclectisme : Une synthèse des écoles, émergente avec Philon, préparant le Moyen Platonisme.
- Scepticisme méthodique : La pratique dialectique d’Arcésilas, qui équilibre les arguments pour révéler l’incertitude.
Polémon d’Athènes (3e scholarchès, -314–270)
Polémon, successeur direct de Xénocrate, recentre l’enseignement de l’Académie sur l’éthique pratique. Il professe une forme de stoïcisme. La métaphysique platonicienne passe au second plan par rapport à la vie conforme à la nature. Polémon est à rapprocher des Cyniques et des premiers Stoïciens.
Polémon participe à une tradition de modération éthique héritée de Socrate et développe un ascétisme moral qui influencera Zénon de Citium.2
Cratès d’Athènes (4e scholarchès, -270–265)
Cratès est le fidèle disciple de Polémon et poursuit son programme centré sur l’éthique. Il semble avoir insisté sur l’importance du comportement moral plus que de la spéculation théorique. Peu d’écrits ou de témoignages subsistent, mais son influence indirecte passe par Arcésilas, son successeur.
Arcésilas de Pitane (5e scholarchès, -265–241)
Arcésilas est le fondateur de la Nouvelle Académie dite sceptique, qui remet en cause ce qui était présenté comme un dogme ou une certitude. Il nie la possibilité d’un savoir certain (epistèmè) et adopte la suspension du jugement (épochè) sur toute question métaphysique.
Postulat
Dans la tradition grecque classique, epistēmè signifie un savoir fondé, démontré, universellement vrai et stable. Chez Platon, cela s’oppose à la doxa (opinion) : la connaissance véritable porte sur les Formes intelligibles (idéalité, éternité), tandis que la doxa porte sur les apparences sensibles (instables, particulières).
Arcésilas nie que l’esprit humain puisse atteindre une telle connaissance certaine, que ce soit dans le domaine physique, éthique ou métaphysique. Il affirme qu’aucune représentation, aucune perception, aucune construction logique ne peut produire un savoir absolument fiable, indubitable. Cela le met en opposition avec les Stoïciens, pour qui il existe des phantasiai kataleptikai (représentations « évidentes », qui saisissent les objets tels qu’ils sont) et les dogmatiques en général.
Conséquence
L’épochè (ἐποχή) signifie « arrêt » ou « retenue ». Dans ce contexte philosophique, c’est le refus d’affirmer ou de nier quoi que ce soit, lorsque l’on reconnaît que toute opinion ou croyance pourrait être fausse. Arcésilas prône cette attitude comme conséquence logique du rejet d’un savoir certain.
Ce principe est appliqué par Arcésilas à toutes les propositions, qu’elles concernent les dieux, l’âme, la vertu ou le monde physique. Il s’inspire ici du philosophe Pyrrhon d’Élis, originaire du nord-ouest du Péloponnèse, sauf que la motivation d’Arcésilas n’est pas une quête d’ataraxie (sérénité) comme chez Pyrrhon d’Élys, mais une exigence rationnelle issue du doute méthodique/logique.
Il introduit la notion de pithanon (le vraisemblable) comme critère d’action, inspiré de Pyrrhon mais distinct par sa méthodologie dialectique platonicienne (car il y a bien quelque chose qui le lie à Platon !).
Le pithanon (πιθανόν) est ce que l’on traduit par le plausible/vraisemblable. Pour Arcésilas, puisqu’on ne peut jamais savoir avec certitude, il faut tout de même vivre et agir dans le monde et le pithanon permet d’orienter l’action.
Le pithanon devient alors un critère pragmatique d’action : c’est ce qui paraît le plus raisonnable ou le mieux justifié à un moment donné, sur la base d’indices, de probabilité, d’expérience ou de discussion. C’est un équivalent philosophique du « bon sens rationnel », mais soumis à la méthode du doute constant.
Dialectique platonicienne
L’orientation prise par les dirigeants de l’Académie de Platon pourrait déconcerter un platonicien convaincu, notamment ceux qui se retrouvent dans sa métaphysique. Où est le lien avec Platon ? À ce stade, c’est dans la dialectique (la méthode et non la doctrine) que se situe le lien de filiation entre chaque scholarchès.
Arcésilas interroge, réfute et croise les arguments comme Socrate dans les dialogues de Platon. Il utilise le raisonnement contre tout dogmatisme. Il ne soutient aucune thèse, mais conteste toutes celles qu’il rencontre. Il pratique la maïeutique socratique avec un sceptique poussé, où le but n’est plus d’accoucher de la vérité (la limite de son lien de filiation avec Platon est ici), mais de montrer qu’on ne peut y prétendre sans excès de confiance.
Maria Chelkowska3 identifie une « lecture sceptique des dialogues » de Platon dans le monde hellénistique (-323-31) de cette période, de Cicéron à Diogène Laërce :
« Eh bien, Platon fait connaître les doctrines qu’il a conçues, il réfute à fond celles qu’il considère comme fausses, et il suspend son jugement devant celles qui sont obscures »4.
Innovations
Arcésilas propose une lecture sceptique du platonisme au sens où il utilise la dialectique socratique sous forme d’attaque systématique des dogmes.
Par ailleurs, à ce stade historique, il existe bien un platonisme conscient. « En désignant ses prédécesseurs comme des « êtres extraordinaires, survivants de l’âge d’or », Arcésilas postulait une continuité qui trouvait une confirmation dans l’attrait grandissant pour la figure de Socrate au sein de l’Académie de Polémon », écrit Mauro Bonazzi5.
Arcésilas « s’est toujours considéré platonicien et il s’est toujours affiché comme tel », précise également Maria Chelkowska.
Lacydès de Cyrène (6e scholarchès, -241–224)
Lacydès est un disciple d’Arcésilas qui persiste dans la voie sceptique introduite radicalement par son prédécesseur. Alors que son mentor pratiquait le scepticisme comme méthode, Lacydès en fait une doctrine. Lacydès institutionnalise en restant sur la voie de son prédécesseur.
Phantasia
Arcésilas niait la possibilité du savoir, tandis que Lacydès admet que certaines impressions peuvent être acceptées comme « pratiques », sans pour autant être déclarées vraies. Il reste un sceptique dans le sens où il prône la suspension du jugement sur les conceptions métaphysiques.
- Plus concrètement, une impression (ou représentation, en grec : phantasia) est ce que l’on perçoit ou croit comprendre :
Une sensation visuelle (« je vois une tasse »), - Une pensée (« je crois que la justice est préférable à l’injustice »),
- Une intuition morale (« aider est une bonne chose »).
Nous avons vu que chez Arcésila, aucune impression ne peut être tenue pour vraie avec certitude, suspendant notre jugement et n’affirmant rien à part une prudence radicale et une action fondée sur la probabilité.
Chez son succeseur Lacydès, la nouveauté est une nuance selon laquelle une phantasia peut être jugée suffisante pour guider raisonnablement l’action, même si on ne dit pas qu’elle est vraie pour autant.
En synthèse, si on voit une échelle posée contre un mur, on peut monter dessus en présumant qu’elle est stable sans affirmer que c’est forcément vrai mais en « confiance raisonnée » (des guillemets résultant de ma propre compréhension de l’idée, qui ne viennent pas d’écrits de Lacydès).
Pithanon
Sous Lacydès, l’utilisation du pithanon (vraisemblable) est distingué selon les contextes :
- perceptifs (comment agir avec des impressions sensibles incertaines),
- moraux (comment prendre des décisions éthiques sans certitude),
- épistémiques (comment dialoguer rationnellement sans prétendre au savoir absolu).
Ce travail prépare le système triadique de Carnéade, qui distinguera trois degrés de pithanon. On peut dire que Lacydès pose les bases conceptuelles de cette hiérarchie.
Carnéade de Cyrène (7e scholarchès, -186–129)
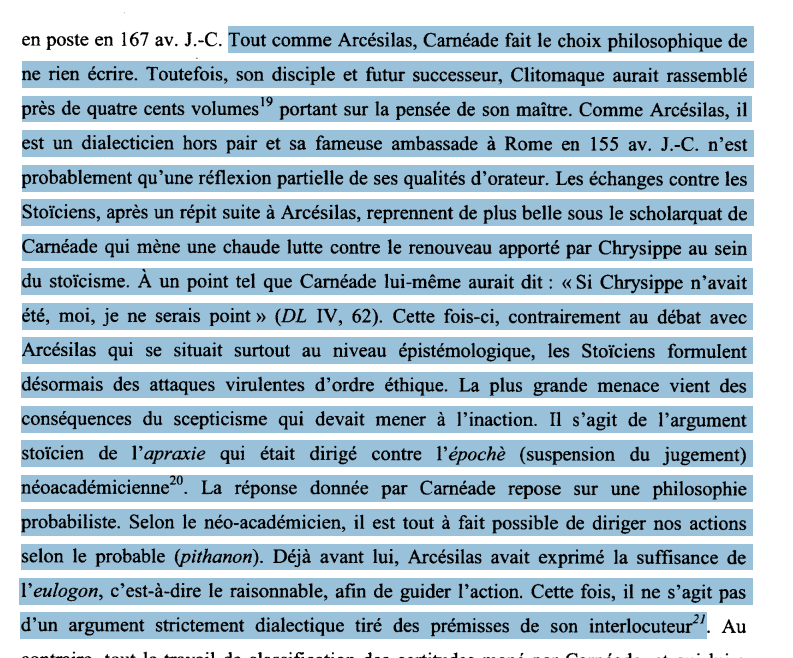
Karnéadys incarne l’apogée du scepticisme de l’Académie. Il développe une théorie hiérarchisée du vraisemblable, distinguant trois niveaux de pithanon :
- Vraisemblance simple,
- Vraisemblance confirmée,
- Vraisemblance testée dans l’action.
Carnéade conteste frontalement le stoïcisme, notamment en niant l’existence des représentations « kataleptiques ». Il s’agit d’une perception qui saisit l’objet tel qu’il est vraiment, de manière claire, évidente, indubitable, à tel point qu’on ne peut pas se tromper si on l’accepte. Elle est marquée par la réalité elle-même. (comme un sceau apposé sur la cire). Elle provient d’un objet réel. Elle est claire et distincte.
Carnéade déclare que l’on ne peut pas distinguer une perception réelle ou fausse et que par conséquent, puisque l’on est toujours susceptible de se tromper sur sa perception, la représentations kataleptiques est infondée. Les illusions sont parfois indiscernables de la réalité, donc même ce qui semble “clair et distinct” peut être faux.
Clitomaque de Carthage (8e scholarchès, 129–110 av. J.-C.)
Disciple direct de Carnéade, il devient le principal exégète et défenseur du scepticisme académique. Il développe une synthèse des thèses de Carnéade, tout en intégrant des éléments plus systématiques. Il écrit plus de 400 ouvrages, aujourd’hui perdus, mais rapportés par Cicéron.
Clitomaque « systématise », c’est à dire qu’il organise, clarifie et codifie ce que Carnéade avait développé de manière plus souple, dialectique et orale.
Alors que Carnéade avait une approche rhétorique, vive, contextuelle, plus ou moins comme Socrate, Clitomaque se veut théoricien et tente de faire de l’approche de Carnéade une méthode formalisée, qui s’apprend.
Ce passage de flambeau ressemble à celui entre Arcésilas et Lacydès. C’est une forme de pattern.
Nous avons noté que Carnéade avait introduit une gradation implicite du pithanon (le vraisemblable) comme critère d’action : simple vraisemblance, vraisemblance confirmé, et enfin Vraisemblance testée dans l’action.
Mais il ne systématise pas cette hiérarchie dans un traité doctrinal. C’est Clitomaque qui formalise cette hiérarchie et explicite vraiment ces trois niveaux. Il les relie à des conditions d’assentiment prudentes, en fonction du contexte. Il montre comment appliquer cette gradation à la morale, la politique, et la vie quotidienne.
Plu qu’un système, Clitomaque propose un mode de vie pour appliquer concrètement le scepticisme. Il décrit comment vivre une vie bonne sans certitudes morales absolues. Il influence Cicéron, en lui transmettant une méthode d’évaluation critique des lois, des décisions, des traditions.
Philon de Larissa (9e scholarchès, -110–86)
Il est le dernier scholarchès de l’Académie avant sa destruction par Sylla.
Avec Philon de Larissa commence l’éclectisme, une tendance à combiner des éléments de différentes écoles philosophiques (platonisme, stoïcisme, aristotélisme) pour former une doctrine cohérente, sans adhérer exclusivement à une seule.
Philon admet la possibilité d’un savoir. Sa synthèse permet notamment un mélange entre scepticisme académicien (ce que nous venons de développer) et dogmatisme platonicien (les origines). Cette position prépare la rupture avec Antiochos d’Ascalon (son élève), figure fondatrice (il est au minimum un précurseur) du Moyen-Platonisme.
Conclusion
Entre -314 et -86, l’Académie évolue d’un platonisme éthique et pratique (Polémon) à une structure sceptique (Carnéade, Clitomaque), avant de revenir partiellement vers un probabilisme dogmatique (Philon).
Ce parcours révèle une capacité rare d’autocritique doctrinale, où la méthode dialectique l’emporte souvent sur l’édifice métaphysique qui fera ensuite son grand retour. L’Académie, bien qu’éteinte matériellement par Sylla, laissera un héritage immense, notamment par l’intermédiaire de Cicéron.
Si comme nous l’avons relevé, la filiation platoniste a existé via la méthode dialectique, la période sceptique a ensuite fait l’objet d’un rejet par le néoplatonisme, distinguant alors Académisme et Platonisme. « La thèse d’une rupture fit l’unanimité et on arriva à séparer les deux termes « académicien » et « platonicien », comme s’il s’agissait de deux traditions distinctes », écrit Bonazzi s’appuyant sur diverses sources.6
En -86, le général romain Lucius Cornelius Sylla, chargé de réprimer la révolte de Mithridate, assiège Athènes après que la ville a soutenu le roi du Pont. Le siège est brutal : selon Plutarque7, Sylla ordonne la destruction des murailles, la coupe des arbres sacrés, et le pillage des sanctuaires pour financer son armée. L’Académie, située dans un bosquet à l’extérieur des murs d’Athènes, est particulièrement touchée.
Les violences à Athènes poussent de nombreux intellectuels, dont les philosophes, à fuir l’Attique. Philon de Larissa s’exile à Rome vers -88. Des enseignements platoniciens persistent ailleurs mais la dispersion des élèves et l’évolution doctrinale qui va suivre marque la fin de la période dite « académicienne ».
Avec la destruction de l’Académie, une nouvelle page du platonisme s’ouvre entre Antiochos d’Ascalon (-130-68) et l’émergence du Néoplatonisme avec Plotinos (205-270).
Références
- Voir la partie 1 : https://plethon.fr/2025/04/07/lacademie-de-platon-partie-1/ ↩︎
- Carlos Lévy, Chapitre II. Le scepticisme de l’Académie, 2018 https://shs.cairn.info/article/PUF_LEVY_2018_01_0021 ↩︎
- Maria Chelkowska, Arcésilas de Pitane : vers une lecture sceptique du platonisme, 2013 https://central.bac-lac.gc.ca/.item?id=MR91000&op=pdf&app=Library&oclc_number=912020502 ↩︎
- Diogène Laërce, Vies, III, 52, cité par Maria Chelkowska (lien ci-dessus) ↩︎
- Mauro Bonazzi, Continuité et rupture entre l’Académie et le platonisme, 2006 https://journals.openedition.org/etudesplatoniciennes/996 ↩︎
- J. Glucker, Antiochus and the Late Academy, Göttingen (Vandenhoek & Ruprecht) 1978, pp. 206-225, et M. Bonazzi, Un dibattito tra academici e platonici sull’eredità di Platone. La testimonianza del commentario anonimo al Teeteto, dans Papiri filosofici IV, Firenze (Olschki) 2002, pp. 52-59. ↩︎
- Plutarque, Vie de Sylla, 12-14 ↩︎