|
Getting your Trinity Audio player ready...
|

Le Pythagorisme, fondé par Pythagoras (dit Pythagore) au VIe siècle avant JC, à Crotone, est un courant philosophique, mathématique et religieux qui a profondément marqué la la pensée occidentale, notamment au moment de la redécouverte du platonisme à la Renaissance.
Il se distingue par sa vision unificatrice, où les nombres sont les principes fondamentaux du cosmos, liant la science, la spiritualité et l’éthique. « Bon nombre de témoignages anciens fonds de Pythagore le maître est la source privilégiée de Platon, quand une tradition également nourrie soutient que c’est à la suite et à l’imitation des pythagoriciens que Platon a accordé une importance remarquable aux mathématiques » écrit Luc Brisson1.
Histoire

Pythagoras, né vers -570 sur l’île grecque à Samos, mort vers -490, est une figure semi-légendaire dont la vie est connue à travers des sources comme Diogène Laërce2. Selon Hérodote, il aurait voyagé en Égypte et à Babylone, absorbant des connaissances géométriques et astronomiques3. Vers -530, il s’installe à Crotone, en Grande Grèce, où il fonde une communauté influente, à la fois école philosophique et confrérie religieuse4. La Grande Grèce, région prospère du sud de l’Italie, offrait un contexte favorable à l’innovation intellectuelle, mais les tensions politiques ont conduit à des persécutions contre les pythagoriciens5.
L’école pythagoricienne était structurée en deux groupes : les akousmatikoi (auditeurs suivant des préceptes oraux) et les mathématikoi (savants étudiant les mathématiques)6. Cette distinction, rapportée par Jamblique, reflète la dualité entre mysticisme et rationalité7. Les pythagoriciens jouaient un rôle politique à Crotone, influençant les élites, ce qui provoqua des conflits, notamment une révolte vers -500 qui dispersa la communauté.
Idées clés du pythagorisme
Philosophie des nombres et arithmologie
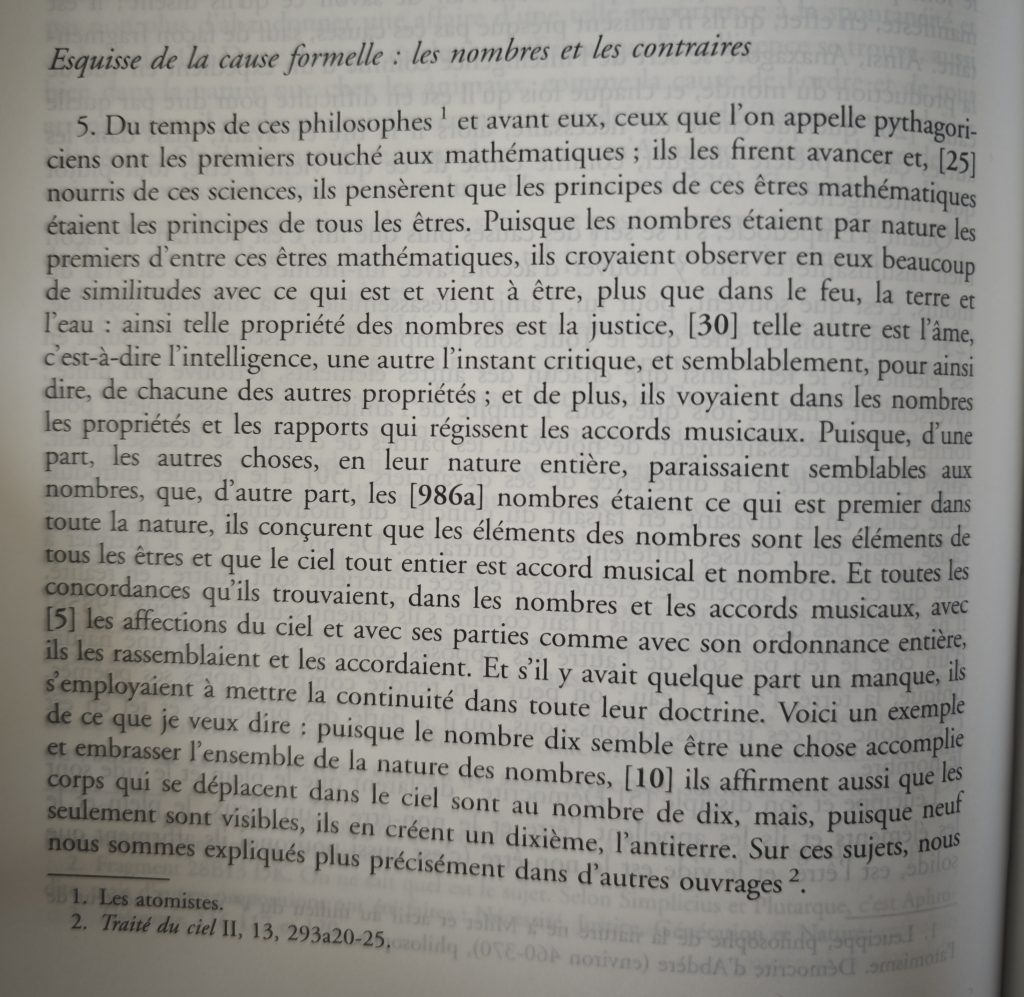
Les pythagoriciens considéraient les nombres comme les principes fondamentaux de l’univers. Aristote rapporte qu’ils affirmaient que « les choses sont des nombres »8. La tétrade (1 + 2 + 3 + 4 = 10) était sacrée, symbolisant la perfection cosmique9. Chaque nombre avait une signification : l’unité (1) représentait l’origine divine, la dyade (2) la dualité, la triade (3) l’harmonie. Cette arithmologie influença la conception d’un cosmos ordonné par des proportions mathématiques, où les rapports numériques (ex. : 2:1 pour l’octave musicale) reflétaient l’ordre universel10. Philolaos, dans ses fragments, développe cette idée en liant les nombres aux structures cosmiques. Philolaos lie les nombres aux structures cosmiques, affirmant que « tout ce qui est connu a un nombre »11. Aristote écrit12 que des pythagoriciens présentaient les principes de la réalité comme étant constitués de dix paires d’opposés, dite la «table des contraires» : carré/oblong; limite/illimitée ; impair/pair ; unité/pluralité ; droite/gauche ; homme/femme ; mouvement/repos ; droit/tordu ; lumière/obscurité ; bon/mauvais.
Cosmologie et harmonie des sphères
Les pythagoriciens ont proposé une cosmologie révolutionnaire, où l’univers est structuré par des rapports numériques. Philolaos décrit un cosmos avec un feu central, autour duquel orbitent la Terre, le Soleil, et les planètes, une idée préfigurant l’héliocentrisme13. Cette vision géométrique contrastait avec les cosmologies mythologiques de l’époque14. Ils croyaient en l’« harmonie des sphères » : les corps célestes, en mouvement, produiraient des sons harmonieux, inaudibles mais révélant l’ordre cosmique15. Platon, dans la République, évoque cette harmonie comme une musique divine produite par les mouvements célestes16.
Métempsycose et éthique
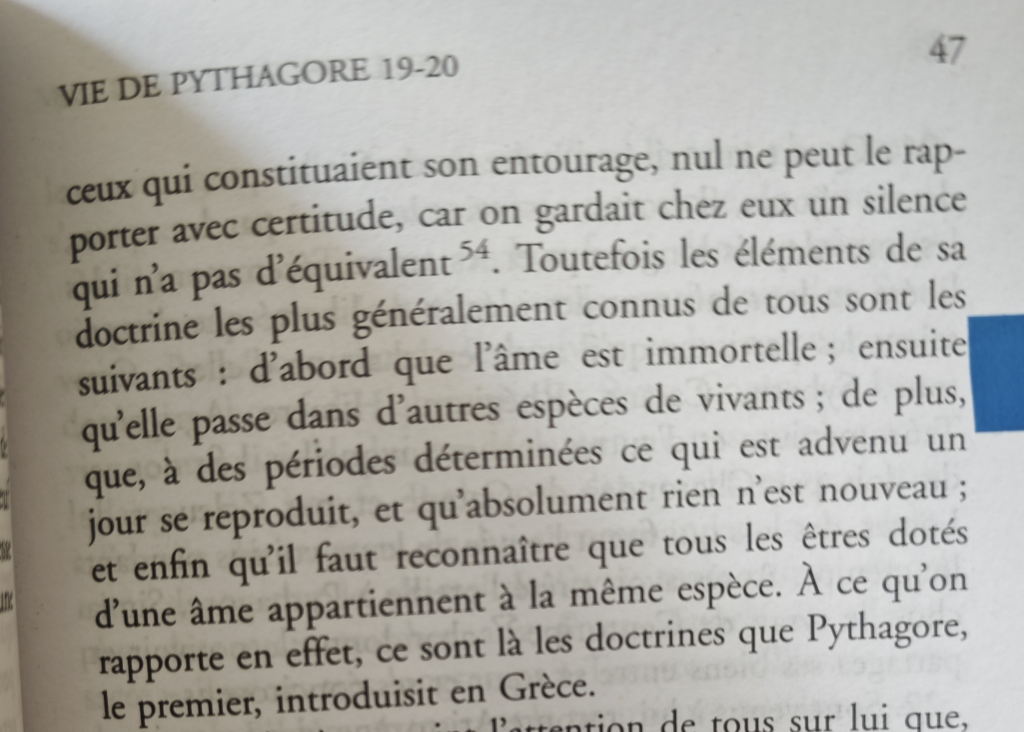
La doctrine de la métempsycose, ou transmigration des âmes, est un pilier du pythagorisme. On retrouve une proximité avec la conception de Platon (Philèbe, Timée17). Xénophane rapporte que Pythagore croyait en la réincarnation, y compris dans des corps animaux18. L’âme, immortelle, passe d’un corps à une autre en fonction des actions passées, imposant une éthique rigoureuse : végétarisme, ascétisme, et purification pour libérer l’âme du cycle des réincarnations19. Ces pratiques, décrites par Porphyre, montrent des parallèles avec l’orphisme et des influences possibles de l’Inde selon Walter Burkert20.
Mathématiques et géométrie
Les pythagoriciens sont célèbres pour leurs contributions mathématiques, notamment le théorème de Pythagore (a² + b² = c²), bien que son attribution directe à Pythagore soit débattue21. Proklos crédite les pythagoriciens pour la systématisation de la géométrie22. Ils découvrirent les nombres irrationnels (ex. : √2), ce qui provoqua une crise conceptuelle, car ces nombres défiaient leur vision d’un monde rationnel23. Les figures géométriques, comme le pentagramme, étaient sacrées, symbolisant l’harmonie cosmique24. Archytas développa la théorie des proportions, influençant Euclide25.
Mode de vie pythagoricien
La communauté pythagoricienne imposait un mode de vie strict, détaillé par Jamblique : abstinence de viande et de fèves, silence rituel, méditation26. Les symbola (préceptes) guidaient les membres, comme « ne pas remuer le feu avec un couteau » (symbole de modération)27. Le végétarisme reflétait le respect de l’âme animale, lié à la métempsycose28. La communauté fonctionnait comme une fraternité, avec des initiations et un serment de loyauté29.
Auteurs et figures principales
Pythagore

Pythagore n’a laissé aucun écrit, et ses idées nous parviennent via des témoignages indirects30. Porphyre le dépeint comme un sage charismatique, mêlant science et mysticisme31. Selon ce dernier, Pythagore a fondé la communauté dite pythagoricienne et posé les bases de ses doctrines.
Premiers pythagoriciens
- Philolaos de Crotone (Ve siècle av. J.-C.) : Premier à écrire sur le pythagorisme, il développe la cosmologie du feu central32. Ses fragments sont une source clé33.
- Archytas de Tarente (IVe siècle av. J.-C.) : Mathématicien et général, il influença Platon et contribua à la théorie des proportions34.
- Autres figures : Hippasos (découverte des irrationnels), Alcmaeon (médecine), et Eurytos (symbolisme numérique) illustrent la diversité des intérêts pythagoriciens35.
Pythagorisme tardif
Le Néopythagorisme (Ier-IIe siècles) revitalise les idées pythagoriciennes, avec des figures comme Apollonios de Tyane et Numenius36. Ces penseurs influencèrent le Néoplatonisme, notamment Plotinos, qui intégra des éléments pythagoriciens dans sa métaphysique37.
Les vers d’or des pythagoriciens
Les Vers d’or de Pythagore constituent une œuvre attribuée à Pythagore. Il s’agit en tout cas d’un poème issu du milieu Pythagoricien. Il pourrait rappeler les maximes Delphiques.
Les Vers d’or commandent d’honorer les dieux les daïmons ainsi que ceux qui nous sont proches. Ils valorisent la Vertu, un mode de vie sain et la piété.

Le texte est connu des Néoplatoniciens et il a fait l’objet d’un commentaire par Hiéroclès d’Alexandrie dans la première moitié du Ve siècle38. Ce dernier présente les Vers d’or comme un ensemble de règles universelles menant à « la philosophie tout entière » (προς την ολην φιλοσοφίαν) au sens où on l’entend à son époque, c’est à dire à la métaphysique et à l’éthique unifiés. Les Vers d’or se superposant très bien avec la pensée Néoplatonicienne, Hiéroclès n’a aucun mal à reprendre les versets pour en développer une réflexion.
Pour le vers « Honore tes parents », il développe une réflexion sur la gratitude filiale, vue comme un reflet de l’ordre cosmique où chaque être doit respecter son génos.
Des liens forts sont faits avec la pensée néoplatonicienne, par exemple lorsqu’il interprète les versets consacrés à l’âme et qu’il y voit un guide pour échapper à la réincarnation pythagoricienne ou platonicienne et revenir plus haut vers les Dieux, dans la hiérarchie divine et cosmique.
Influences
Influences sur le pythagorisme
Les voyages de Pythagore en Égypte et à Babylone, rapportés par Hérodote, suggèrent des influences orientales : géométrie égyptienne, astronomie babylonienne, concepts de réincarnation proches de l’Inde39. L’orphisme grec, avec ses rites purificateurs et sa croyance en l’immortalité de l’âme, est une autre source probable40.
Impact du pythagorisme
- Platon : Dans le Timée, il adopte l’idée d’un cosmos mathématique41. Le Philèbe évoque une méthode pythagoricienne de classification42. Sa théorie des Idées doit beaucoup aux nombres pythagoriciens43.
- Aristote : Il critique les pythagoriciens pour avoir confondu nombres et substances, mais reconnaît leur influence44.
- Science hellénistique : Euclide et Ptolémée s’appuient sur les bases géométriques pythagoriciennes45.
- Modernité : Kepler, dans Harmonices Mundi, reprend l’harmonie des sphères46.
Débats universitaires
L’absence d’écrits de Pythagore complique l’étude du pythagorisme47. Les sources primaires (Platon, Aristote) sont fiables mais fragmentaires, tandis que les biographies tardives (Diogène Laërce, Porphyre) mélangent faits et légendes48. Burkert avance que le théorème de Pythagore pourrait être une découverte collective49. Zhmud distingue le pythagorisme ancien (scientifique) du néopythagorisme (spéculatif)50. Huffman débat de l’authenticité des fragments de Philolaos51.
Conclusion
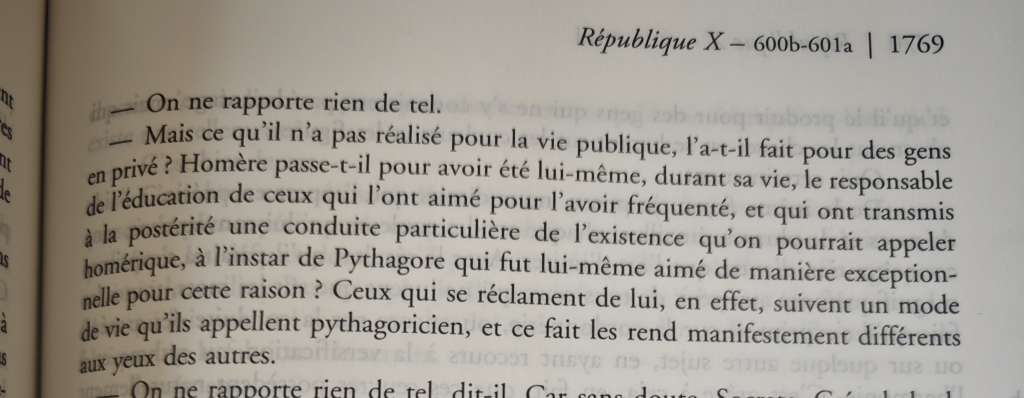
Le pythagorisme allie rationalité mathématique et mysticisme. Ses contributions aux mathématiques, à la cosmologie et à l’éthique ont façonné la philosophie et la science occidentales. Son héritage perdure dans la géométrie euclidienne, les idées platoniciennes, et les conceptions modernes de l’harmonie universelle.
Les œuvres complètes de Platon citent une fois Pythagore dans la République (Livre X 600a-b) et une fois les pythagoriciens, toujours dans la République (Livre VII, 530c 531a). Ce n’est pas choquant puisque Platon cite très peu ses influences. Platon compare Pythagore à Homère en tant qu’éducateur, considération assez élogieuse.
Références
- Luc Brisson. Lire Platon. PUF, Page 15 ↩︎
- Diogène Laërce. Vies et doctrines des philosophes illustres, VIII, 1-50. ↩︎
- Hérodote. Histoires, II, 123. ↩︎
- Walter Burkert. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. https://www.jstor.org/stable/j.ctv1kz4h6p. ↩︎
- Leonid Zhmud. Pythagoras and the Early Pythagoreans. Oxford University Press ↩︎
- Jamblique. Vie de Pythagore, 81-82. ↩︎
- Huffman, C. A. (2005). Archytas of Tarentum: Pythagorean, Philosopher and Mathematician King. Cambridge University Press, page 32. ↩︎
- Aristote. Métaphysique, 985b ↩︎
- Philolaos. Fragments, DK 44 B5, ↩︎
- Kahn, C. H. (2001). Pythagoras and the Pythagoreans: A Brief History. Hackett Publishing, page 25. Kahn souligne que les pythagoriciens voyaient les rapports numériques, comme 2:1 pour l’octave musicale, comme des reflets de l’ordre universel. ↩︎
- Philolaos. Fragments, DK 44 B1 ↩︎
- Aristote. Métaphysique, 986a ↩︎
- Philolaos. Fragments, DK 44 B6 ↩︎
- Leonid Zhmud. Pythagoras and the Early Pythagoreans. Oxford University Press ↩︎
- Cornelli, G., & McKirahan, R. (2013). In the Light of the Moon: Pythagoreanism in the Western Tradition. Academia Verlag https://www.persee.fr/doc/phlou_0776-5552_2015_num_113_2_3517 ↩︎
- Platon. République, X, 617b ↩︎
- Dans la République , Platon distingue l’âme en trois espèces, dont la première est immortelle en soi. Dans le Philèbe et le Timée, l’existence de l’âme est basée sur des cycles de 10 000 ans et un système de rétribution fondé sur la métensomatose. L’âme est séparée des corps pendant un millénaire. Ensuite, pendant neuf millénaires, l’âme passe de corps en corps selon un critère qualitatif basé sur la raison au cours de l’existence précédente. ↩︎
- Xénophane. Fragments, DK 21 B7 : Xénophane rapporte une anecdote où Pythagore reconnaît l’âme d’un ami dans un chien. ↩︎
- Porphyre. Vie de Pythagore, 19 ↩︎
- Walter Burkert. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. Harvard University Press ↩︎
- Proklos. Commentaire sur le premier livre des Éléments d’Euclide, I ↩︎
- Proklos. Commentaire sur le premier livre des Éléments d’Euclide, I ↩︎
- Huffman, C. A. Archytas of Tarentum: Pythagorean, Philosopher and Mathematician King. Cambridge University Press ↩︎
- Walter Burkert. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. Harvard University Press, page 187. ↩︎
- Archytas. Fragments, DK 47 B1 ↩︎
- Jamblique. Vie de Pythagore, 68-70. ↩︎
- Porphyre. Vie de Pythagore, 42 ↩︎
- Kahn, C. H. (2001). Pythagoras and the Pythagoreans: A Brief History. Hackett Publishing ↩︎
- Jamblique. Vie de Pythagore, 72 ↩︎
- Leonid Zhmud. Pythagoras and the Early Pythagoreans. Oxford University Press ↩︎
- Porphyre. Vie de Pythagore, 2 ↩︎
- Philolaos. Fragments, DK 44 B1-B7 ↩︎
- Huffman, C. A. (1993). Philolaus of Croton: Pythagorean and Presocratic. Cambridge University Press ↩︎
- Archytas. Fragments, DK 47 B1. ↩︎
- Leonid Zhmud. Pythagoras and the Early Pythagoreans. Oxford University Press ↩︎
- O’Meara, D. J. (1989). Pythagoras Revived: Mathematics and Philosophy in Late Antiquity. Oxford University Press ↩︎
- Plotinos. Ennéades, V, 1. ↩︎
- https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782251447988/commentaire-sur-les-vers-d-or-des-pythagoriciens-suivi-de-traite-sur-la-providence ↩︎
- Hérodote. Histoires, II, 123 ↩︎
- Platon. Cratyle, 400c ↩︎
- Platon. Timée, 35b-36b ↩︎
- Platon. Philèbe, 16c-d ↩︎
- Kahn, C. H. (2001). Pythagoras and the Pythagoreans: A Brief History. Hackett Publishing, page 82 ↩︎
- Aristote. Métaphysique, A, 5, 987a ↩︎
- Archytas of Tarentum: Pythagorean, Philosopher and Mathematician King. Cambridge University Press, p. 145 ↩︎
- Kepler, J. (1619). Harmonices Mundi, Livre V ↩︎
- Leonid Zhmud. Pythagoras and the Early Pythagoreans. Oxford University Press ↩︎
- Diogène Laërce. Vies et doctrines des philosophes illustres, VIII. ↩︎
- Walter Burkert. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. Harvard University Press, page 428 ↩︎
- Leonid Zhmud. Pythagoras and the Early Pythagoreans. Oxford University Press, p. 167 ↩︎
- Huffman, C. A. (1993). Philolaus of Croton: Pythagorean and Presocratic. Cambridge University Press ↩︎