|
Getting your Trinity Audio player ready...
|

Déméter, déesse olympienne, est fille de Kronos et Rhéa, et sœur de Zeus, Hadès, Poséidon, Héra et Hestia. Son nom, Dē-mētēr (dē = terre, mētēr = mère), désigne la « mère de la terre » ou « mère nourricière ». Elle est l’une des douze grandes divinités olympiennes, principalement associée :
- à l’agriculture, notamment aux céréales
- aux cycles naturels de la fertilité
- à la maternité et au lien mère-fille
Δημήτηρ incarne donc des forces vitales de la nature (sans remplacer la divinité primordiale, Gaïa), plus particulièrement la fertilité agricole, les moissons, le blé, la subsistance humaine et la maternité nourricière.
Déméter est l’instigatrice de l’agriculture et du cycle des saisons, fondements de la civilisation. Cette caractéristique l’inscrit dans une temporalité cyclique (saisons, germination) et une fonction régulatrice de la vie sociale, morale et politique. Nous avons relevé1 que sa fille, Perséphone, s’inscrit également dans une fonction régulatrice en cycle.
La Déesse Deméter, au sein du panthéon grec, est la meilleure incarnation de la troisième fonction (fonction de fécondité et prospérité) dans la trifonctionnalité indo-européenne selon Dumézil2.
Récit

Le récit fondamental de Déméter est transmis par l’Hymne homérique à Déméter (-VIIe siècle). Hadès enlève Perséphone (Koré), la fille de Déméter, pour en faire son épouse. Dévastée, la déesse Déméter cesse de faire croître les cultures jusqu’à ce que Zeus ordonne le retour de Perséphone. Cette dernière, ayant goûté au fruit des enfers (grenade), est contrainte d’y demeurer périodiquement3.
Ce mythe structure l’origine des saisons, et surtout celle des Mystères d’Éleusis, un culte à mystère lié à la mort et à la renaissance, à la nature et à l’éternité de l’âme humaine. Le récit pose Déméter comme une figure de passage, d’enseignement et de transformation.
Cultes
Walter Burkert, dans son ouvrage de référence, La religion grecque, précise que Demeter « possède souvent son sanctuaire sur une colline » en face de la cité « créant par là une certaine polarité par rapport à la vie quotidienne de la polis »4. Les lieux de cultes disposent souvent des sources d’eau, ceux dédiés à Déméter en particulier5.
Précisant que Déméter est désignée, avec Dionysos, comme bénéficiaire du sacrifice des fêtes des Haloa, Burkert nous montre que le culte de Déméter est particulièrement marquant lors des Thesmophories et dans les Mystères d’Éleusis.
Les Thesmophoria
Pour honorer la déesse Déméter en tant que déesse de la fertilité de la terre et de la population, les femmes organisent une célébration sans les hommes et à l’écart, par exemple au flanc de l’Acropole.
Elles se rassemblent au lieu où des abris artificiels (skenai) sont construits. Les femmes s’organisent sous la houlette de deux « archouzai ». Les enfants qui ne sont pas des nourrissons ainsi que les vierges sont tenus de rester à l’écart.
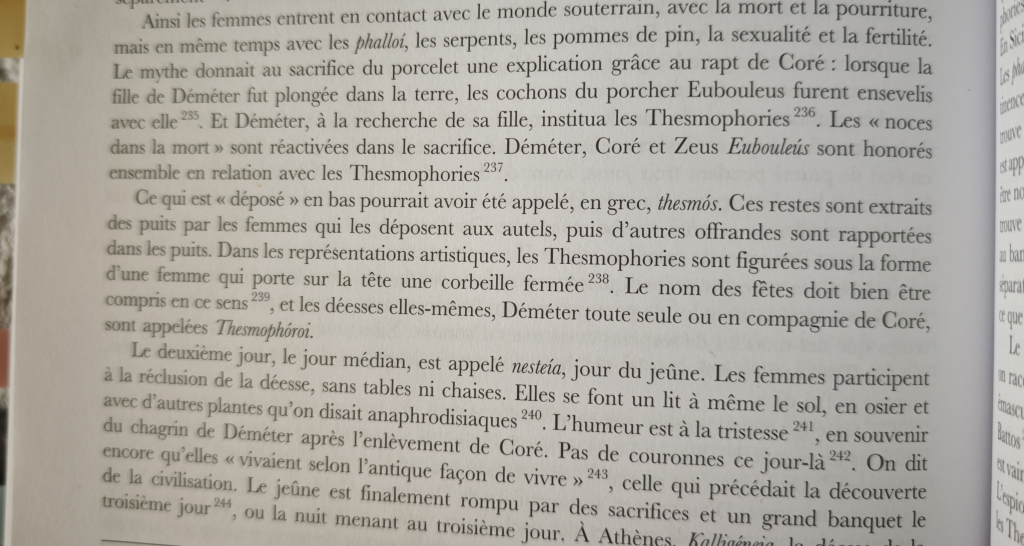
Dans des villes comme Athénes ou Sparte, les célébrations durent 3 jours du 11 au 13 du mois de Pyanopsion. A Athènes spécifiquement, le premier jour nommé anodos (remontée) était le théâtre d’une procession féminine.
Un porc est sacrifié et ses restes sont traités. Les « puiseuses » récupèrent les restes décomposés et les conserves avant de les placer sur des autels. Une pâte était réalisée et servait à la confection de choses sacrées. Des rituels et des représentations artistiques ont lieu. Le jour suivant est consacré au jeune et à la tristesse, en relation avec celle ressentie par Déméter après l’enlèvement de sa fille Perséphone.
Les Thesmophoria sont empreintes de sérieux, de tristesse et surtout de pureté.
Les Mystères d’Éleusis
Les cultes à Mystères, dont je traiterai le sujet en profondeur à l’avenir, ne sont pas un culte officiel de la cité. Ce n’est pas la religion officielle. Cependant, les cultes à mystères de l’Antiquité, que l’on pourrait comparer à des sociétés secrètes par opposition à la religion civique du culte de la cité, se rapprochent assez de ce que l’on appelle une religion depuis l’émergence du monothéisme.
Les Mystères d’Éleusis étaient l’un des principaux cultes à mystère de l’Antiquité. Encore une fois , c’est auprès de Walter Burkert – un des plus grands experts des cultes à mystère dans l’Antiquité – que nous pouvons trouver des sources fiables, via son ouvrage Les cultes à mystère dans l’Antiquité.
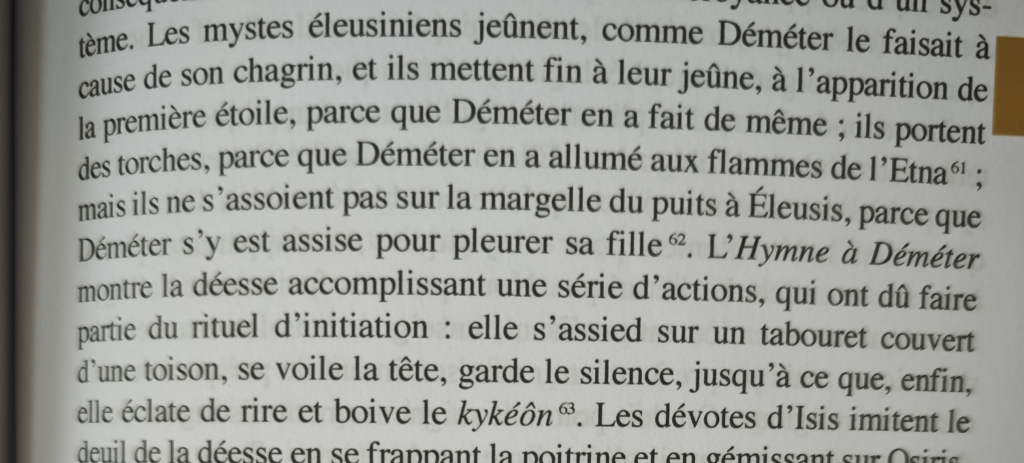
Par opposition au culte de la cité qui était civique et publique Les Cultes à mystère constituaient la première forme de religion individuelle et surtout ésotérique. Les cultes à mystères n’étaient pas considérées comme la vraie religion officielle de la cité mais comme une forme de société secrète qui évoluait en marge et dont l’appartenance n’était en rien un devoir.
Walter Burkert écrit que les Mystères d’Éleusis étaient consacrés à deux déesses, Déméter et sa fille Perséphone6. L’archonte-roi de la cité d’Athènes organisait et supervisait les Mystères d’Éleusis, renommés localement les Mystères, tout court. Georgios Gémistos Pléthon précise dans le Traité des Lois7 que l’âme était révélée comme immortelle au cours des initiations.
L’objectif des mystères d’Éleusis était de prendre soin de son âme. Le rôle de Demeter dans ce cadre était son autre don après la production de céréales, c’est-à-dire la promesse d’une vie après la mort (pour ceux qui ont vu les Mystères8.
Théologie
Déméter dans le platonisme

Platon ne mentionne pas directement Déméter, mais son intérêt pour les cultes à mystères influence les néoplatoniciens. Dans le Cratyle, l’étymologie des noms divins suggère que Déméter pourrait symboliser la fécondité universelle.
Chez Proklos, compte tenu de la place donnée à Perséphone/Koré dans la Théologie platonicienne, on peut supposer un rôle transcendant d’Hénade chez Déméter, certainement dédié à la cyclicité (ce qui n’est pas dit explicitement mais qui est cohérent avec le rôle de la triade corique).
Autres courants philosophiques
- Stoïcisme : Les stoïciens rationalisent Déméter comme une personnification des forces naturelles, alignée sur le logos cosmique.
- Épicurisme : Les épicuriens, comme Épicure, considèrent Déméter comme un symbole culturel.
- Pythagorisme : Le récit de Déméter et Perséphone est vu comme une allégorie des cycles cosmiques, en résonance avec les pratiques ésotériques pythagoriciennes.
Épiclèses
Voici les épiclèses de Déméter les plus représentatifs, une liste qui n’est pas exhaustive.

Thesmophoros (Θεσμοφόρος – « Porteuse des lois »)
- Signification : Elle apporte les lois et l’ordre social par l’agriculture et la fertilité.
- Diffusion : Très largement répandue dans toute la Grèce, notamment à Athènes, mais aussi à Syracuse, Argos, Delphes, Délos, etc.
- Lien cultuel : Associée aux Thesmophoria.
- Période : Attestée dès le -VIIe siècle (Hésiode, Homère), pratiquée pendant toute l’époque classique.
- Sources : Inscriptions cultuelles (IG I³ 78), Aristophane (Thesmophories), Pausanias.
Chthonia (Χθωνία – « De la Terre » / « Souterraine »)
- Signification : Déméter comme divinité chthonienne, liée aux enfers et aux ancêtres
- Diffusion : Présente surtout à Hermione (Argolide) et Sparte9, donc culte localisé, souvent dorien.
- Lien cultuel : Culte partagé avec Hadès ou Coré.
- Période : Attesté à partir du -VIe siècle jusqu’à l’époque hellénistique.
- Sources : Pausanias (II, 35, 4 ; III, 11, 10), IG IV², inscriptions lacédémoniennes.
Erinys (Ἐρινύς – « Vengeresse »)
- Signification : Aspect terrible et vengeur de Déméter, notamment après le viol de Perséphone.
- Diffusion : Spécifique à Arcadie (notamment à Thelpousa, Phigalie).
- Lien cultuel : Lien avec les déesses infernales comme les Érinyes.
- Période : Attestée au -IVe siècle par Pausanias (VIII, 25, 3–6) ; peut être antérieure.
- Sources : Pausanias, tradition orphique.
Malophoros (Μηλοφόρος – « Porteuse de pommes » ou « Porteuse de brebis »)
- Signification : Épiclèse ambivalente, parfois « porteuse de fruit » (μῆλον = pomme) ou de « mouton » (μῆλον = brebis).
- Diffusion : Présente à Sicile (Ségeste), en Arcadie, et dans le monde dorien.
- Lien cultuel : Culte de fertilité, lié à l’abondance.
- Période : Attestée au -Ve siècle dans l’épigraphie.
- Sources : IG XIV (Ségeste), Pausanias.

Eleusinia Déméter (Έλευσίνια – « Déméter d’Éleusis »)
- Signification : Déméter en tant que divinité d’Éleusis, protectrice des mystères.
- Diffusion : Essentiellement locale à Éleusis, mais culte influent dans toute la Grèce.
- Lien cultuel : Mystères d’Éleusis, rites initiatiques secrets.
- Période : Très ancienne ; attestée depuis le -VIIe siècle et florissante jusqu’à l’époque romaine.
- Sources : Hymne homérique à Déméter, Pausanias, inscriptions éléusines.
Anesidora (Ἀνησιδώρα – « Celle qui envoie des dons »)
- Signification : Déméter qui « envoie les bienfaits », souvent les récoltes.
- Diffusion : Attestée principalement à Phigalie (Arcadie).
- Lien cultuel : Aspect bienveillant et nourricier.
- Période : -Ve au -IVe siècles, mentionnée par Pausanias (VIII, 42).
- Sources : Pausanias, inscriptions locales.

Khloe (Χλόη – « Verte », « Herbe tendre »)
- Signification : Incarnation du printemps, des jeunes pousses.
- Diffusion : Présente à Athènes, dans les cultes de printemps.
- Lien cultuel : Renouveau de la végétation.
- Période : Attestée dans la période classique.
- Sources : Inscriptions attiques, scholies.
Lusios/Lusia (Λύσιος / Λυσία – « Libératrice »)
- Signification : Déméter comme libératrice des souffrances, en lien avec les mystères.
- Diffusion : Culte élusiniaque, surtout à Éleusis, mais symbolique présente ailleurs.
- Lien cultuel : Associée à la catharsis spirituelle des mystères.
- Période : Attestée dès la période de la Grèce classique.
- Sources : Inscriptions cultuelles à Éleusis et à Samothrace.
Damatēr Megalē (Δαμάτηρ μεγάλη – « Grande Déméter »)
- Signification : Forme majestueuse et honorifique.
- Diffusion : Assez généralisée dans les hymnes et prières.
- Lien cultuel : Panhellénique
- Période : Déjà présente dans l’Hymne homérique à Déméter (environ au -VIIe siècle).
- Sources : Hymne homérique à Déméter, inscriptions panhelléniques.
Déméter Potnia (Δήμητερ Πότνια – « Maîtresse »)
- Signification : Épiclèse très ancienne, utilisée pour de nombreuses divinités dans le monde mycénien.
- Diffusion : Mycènes, Pylos, attestée dans les tablettes en linéaire B (da-ma-te).
- Lien cultuel : Usage pré-archaïque, très ancien.
- Période : -XIVe au –XIIe siècles
- Sources : Tablettes en linéaire B (KN V 52, PY Tn 316).
Références
- https://plethon.fr/2025/03/24/athena/ ↩︎
- https://plethon.fr/2025/03/10/la-theorie-de-la-trifonctionnalite-chez-les-aryens-indo-europeens/ ↩︎
- Le récit consacré à Perséphone est beaucoup plus long et complexe que cela mais ce n’est pas l’objet principal de cet article. ↩︎
- Walter Burkert. La religion grecque. Page 125, traduction française ↩︎
- Walter Burkert. La religion grecque. Page 127, traduction française ↩︎
- Walter Burkert. Les cultes à Mystères dans l’Antiquité. Les Belles Lettres, page 7 ↩︎
- Georges Gémiste Pléthon. Traité des lois. Traduction du XIX siècle, page 31 ↩︎
- Walter Burkert. La religion grecque. Page 24, traduction française ↩︎
- https://plethon.fr/2025/02/10/lorganisation-divine-et-cosmique-de-sparte-partie-1/ ↩︎