
Georges Dumézil (1898-1986) a révolutionné les études indo-européennes avec sa théorie de la trifonctionnalité. Cette théorie qui n’a rien perdu de sa pertinence repose sur une idée centrale : les cultures indo-européennes, qu’il s’agisse de leurs mythes, panthéons ou institutions sociales, sont structurées autour de trois fonctions fondamentales. En comparant les traditions indiennes, gréco-romaines, germaniques et celtiques, Dumézil a identifié des correspondances qui témoignent d’une vision sociale et cosmologique commune.
Origines de la théorie et méthodologie
Un cadre comparatif
Dans les années 1930, Dumézil élabore sa théorie en étudiant les mythes et les structures sociales des peuples indo-européens. Il s’appuie sur une méthodologie comparative qui dépasse les frontières linguistiques pour explorer les similarités dans les récits mythologiques, les institutions politiques et les hiérarchies sociales.
Avant Dumézil, les études indo-européennes se concentraient sur la linguistique comparée, avec des figures comme Franz Bopp et August Schleicher. Dumézil introduit une approche différente, basée sur l’analyse structurelle des mythes et des institutions.
Dans Mythes et dieux des Indo-Européens (1981), Georges Dumézil explique que les structures trifonctionnelles ne sont pas des coïncidences, mais des traces d’une idéologie commune qui a imprégné les mythes et les sociétés.
Les trois fonctions : une organisation sociale et divine
Première fonction : Le sacré et la souveraineté
La première fonction concerne la souveraineté, à la fois religieuse et politique. Elle se divise en deux aspects complémentaires :
- La souveraineté juridique, incarnée par les rois ou chefs politiques, qui garantissent l’ordre et la justice.
- La souveraineté spirituelle, exercée par les prêtres ou les sages, qui établissent un lien entre le divin et le monde humain.
En pratique, Dumézil identifie les Dieux indiens, Varuna et Mitra, qui représentent respectivement la souveraineté cosmique (loi et ordre universels) et la gestion sociale (alliances et serments).
Dumézil souligne dans L’idéologie tripartite des Indo-Européens (1958) que la souveraineté double, répartie entre le roi et le prêtre, reflète la tension entre ordre humain et ordre divin.
Cette lecture est très bien adaptée à l’organisation divine et cosmique de Sparte1, où Zeus Basileus incarne la souveraineté juridique tandis que Zeus Ouranios incarne la souveraineté spirituelle.
La particularité de la religion grecque est de considérer Que cette souveraineté s’accompagne de deux autres celles de Poséidon et Hadès. On retrouve ce particularisme dans la religion spartiate et dans l’ouvrage Théologie platonicienne de Proklos (livre 6)2 où « les trois pères » sont considérés comme les trois démiurges souverains sur le monde cosmique.
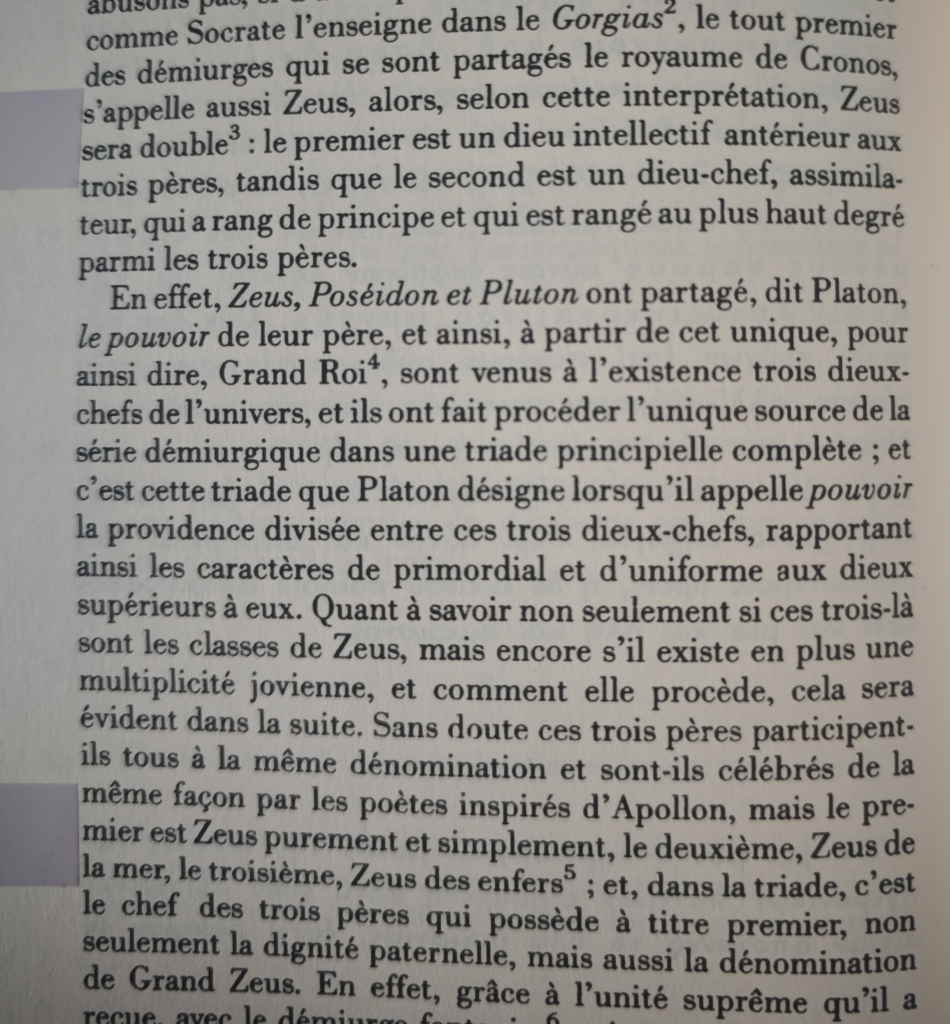
Deuxième fonction : La force et la guerre
La deuxième fonction symbolise la force militaire et la capacité à protéger la communauté. Elle est associée aux guerriers, à la violence contrôlée et à la bravoure héroïque.
Exemples :
- Inde : Indra, le dieu du tonnerre, incarne cette fonction en triomphant de Vritra pour libérer les eaux célestes.
- Rome : Mars, dieu de la guerre, est le protecteur militaire de la cité.
- Grèce : Arès, dieu de la guerre brute, et Athéna, déesse de la stratégie, représentent les deux faces de cette fonction. Tandis qu’Arès illustre la violence furieuse et déchainée dans le feu de l’action, Athéna incarne la guerre au plus près de la logique et de la sagesse, pouvant tenir compte des principes de la justice.
Dumézil écrit que la fonction guerrière est essentielle, non pour créer, mais pour protéger ce qui a été établi par la souveraineté. (Les Dieux des Indo-Européens, 1952).
À Sparte les divinités du domaine de la guerre étaient nombreuses. Citons Athéna Chalkioikos ainsi que Enyalos.
Troisième fonction : La fécondité et la prospérité
La troisième fonction est liée à la production, la reproduction et l’abondance. Elle concerne les agriculteurs, les artisans et la continuité de la communauté.
Exemples :
- Inde : Les Ashvins, dieux de la fertilité et des soins, favorisent la prospérité et le bien-être.
- Rome : Cérès, déesse de l’agriculture, est une figure majeure de cette fonction.
- Grèce : Déméter, déesse de la moisson, assure la fertilité de la terre. Dionysos, dieu du vin et de l’abondance, symbolise également la prospérité, mais dans une dimension plus festive et libératrice. La déesse Artémis, liée à la lune et à la chasse, est également en rapport avec cette fonction.
Dumézil insiste sur le rôle vital de cette fonction, la prospérité n’est pas une finalité secondaire, mais le socle sur lequel repose toute société fonctionnelle (L’Héritage indo-européen à Rome, 1949).
À Sparte, ce rôle est incarné très classiquement par Déméter, mais aussi par Poséidon Hippios.
La théologie et la religion dans la trifonctionnalité
Une cosmologie tripartite
Dumézil montre que la structure trifonctionnelle ne se limite pas aux sociétés humaines. Elle imprègne également les visions cosmologiques et théologiques des Indo-Européens. Les divinités sont organisées selon les trois fonctions, reflétant une conception harmonieuse de l’univers.
En Grèce, cette organisation apparaît dans la répartition des rôles divins :
- Souveraineté : Zeus, dieu du ciel et de la foudre, établit les lois et maintient l’ordre.
- Guerre : Arès et Athéna, représentants complémentaires de la puissance martiale.
- Fécondité/prospérité : Déméter, Artémis et Dionysos, liés à la fertilité et aux cycles naturels.
Les rites religieux et les cultes
Les rites religieux sont souvent structurés de manière à refléter cette tripartition. Par exemple, à Sparte, un autel était dressé pour :
- Zeus, le souverain.
- Athéna, ou Arès selon les sources, dans les deux cas incarnant la fonction guerrière.
- Les Dioscures, certes modèles guerriers de la cité mais d’abord incarnation de la jeunesse et se rapportant à la troisième fonction de Dumézil par rapport aux autres.
L’exemple des cycles thébains et troyen
Les récits associés à Thèbes et à Troie intègrent également cette structure. Le rôle des trois fonctions se reflète dans les dynamiques entre les héros et les dieux. Par exemple, lors du jugement de Pâris :
- Héra promet la souveraineté (première fonction).
- Athéna offre la victoire militaire (deuxième fonction).
- Aphrodite propose l’amour et la fécondité (troisième fonction).
Réception et critiques
Une contribution majeure
La théorie de Dumézil a influencé profondément les études sur la mythologie et les sociétés anciennes. Elle a permis de relier des traditions apparemment distinctes en révélant une idéologie commune.
L’anthropologue Claude Lévi-Strauss a salué la portée structuraliste de cette approche : « Dumézil a donné aux mythes une profondeur universelle en leur redonnant une structure. »
Si sa théorie est largement acceptée, elle a suscité des débats :
- Bruce Lincoln critique une approche trop rigide et idéologique.
- Jean Haudry et Bernard Sergent la complètent avec des nuances.
- John B. Bury et d’autres historiens questionnent l’universalité du modèle.
Si nous continuons d’appliquer la trifonctionnalité à la religion spartiate, nous constatons une certaine cohérence sans que la théorie se révèle un absolu.
Je note pour ma part qu’une fonction de l’identité et de la cohésion, incarnée par Apollon Amyklaios mais aussi par Athémis Orthia, se révèle aussi centrale que chacune des trois fonctions de Dumézil. Mais cela n’est vrai que pour Sparte et ne remet pas en cause la théorie de la trifonctionnalité pour l’ensemble de la religion nationale grecque. Par ailleurs, cette conception se débat.
Héritage et pertinence contemporaine
Aujourd’hui, la théorie de la trifonctionnalité reste une référence incontournable pour l’étude des Indo-Européens. Elle est utilisée comme cadre analytique dans la mythologie comparée, mais aussi dans l’histoire sociale et la littérature.
Comme Dumézil l’écrit, ces structures, si anciennes soient-elles, parlent encore aux sociétés modernes. Elles révèlent un besoin fondamental d’ordre et de sens. (Entretiens avec Didier Éribon, 1986).
Références
- https://plethon.fr/2025/02/10/lorganisation-divine-et-cosmique-de-sparte-partie-1/ ↩︎
- Proklos (1997). Théologie Platonicienne. Les Belles Lettres
Dumézil, G. (1958). L’idéologie tripartite des Indo-Européens. Gallimard
Dumézil, G. (1981). Mythes et dieux des Indo-Européens. Flammarion
Dumézil, G. (1949). L’Héritage indo-européen à Rome. Presses Universitaires de France
Lincoln, B. (1991). Death, War, and Sacrifice: Studies in Ideology and Practice. University of Chicago Press
Lévi-Strauss, C. (1983). Le regard éloigné. Plon
Littleton, C. S. (1973). The New Comparative Mythology. University of California Press ↩︎