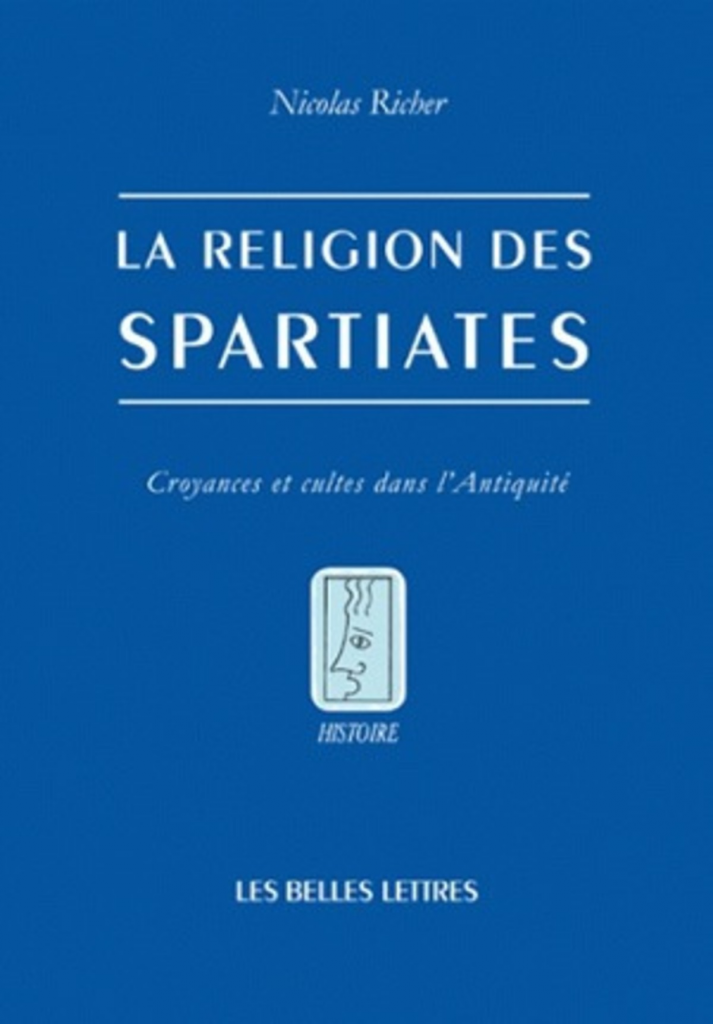|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Domaine 12 : La Maitrise de soi
La rigueur et la piété spartiates, d’un niveau rarement égalé dans l’histoire, impliquait une maîtrise de soi omniprésente. Le culte de sept divinités correspondent à ce domaine du Divin.
Dans son ouvrage La Religion des Spartiates (Les Belles Lettres, 2012), Nicolas Richer utilise le terme de pathémata pour regrouper les volontés divines se rapportant aux émotions humaines fondamentales. Cess dernières sont intégrées aux pratiques cultuelles et à l’éducation spartiate :
- Phobos (la peur)
- Eros (l’amour)
- Limos (la faim)
- Thanatos (la mort)
- Hypnos (le sommeil)
- Gelos (le rire)
- Aidos (la honte et l’honneur)
Contrairement aux Dieux olympiens qui régissent des sphères précises du cosmos, les « pathémata » relèvent davantage des Daïmons, des divinités intermédiaires entre les Dieux et les Hommes.
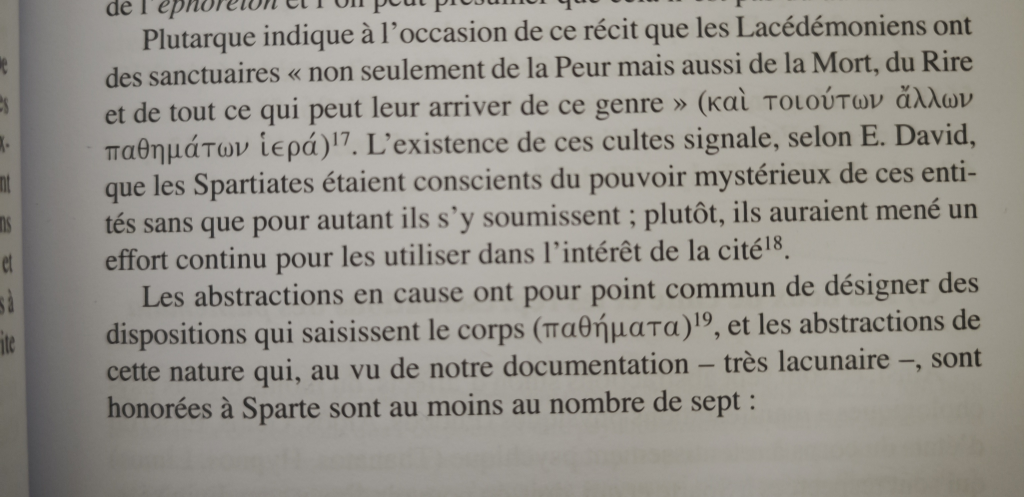
Plutôt que des incarnations d’une émotion, il faut comprendre les cultes de la maîtrise de soi comme étant une force pour accomplir son devoir. C’est notamment Plutarque1 qui apporte un éclairage à ce sujet (voir la citation ci-contre)
Par exemple, Phobos, la peur, n’est pas simplement une terreur subie, mais une arme spirituelle utilisée pour inspirer l’effroi chez l’ennemi. De même, Limos, la faim, est vénéré pour aider les jeunes spartiates à supporter les privations lors de l’agôgè (éducation spartiate).
Phobos (Φόβος) – La Peur

Phobos est la personnification de la peur et de la panique guerrière. Chez les Spartiates, son culte est lié à la tactique militaire et à la domination psychologique du champ de bataille.
Pausanias (Livre 3.17.4) mentionne un sanctuaire de Phobos à Sparte. Plutarque (Vie de Cléomène, 9) relate que la peur était une force intégrée dans la stratégie spartiate
Les Spartiates cherchaient à contrôler Phobos en l’invoquant avant les batailles, transformant une faiblesse potentielle en un atout stratégique.
Eros (Ἔρως) – L’Amour et le Désir

Contrairement à l’Eros au sens grec général qui symbolise l’amour charnel et le désir incontrôlé, l’Eros spartiate représente un amour maîtrisé, servant notamment la camaraderie militaire. Platon et Xénophon font mention d’un lien entre Eros et l’éducation militaire spartiate.
Ce culte visait à renforcer les liens entre guerriers, favorisant la solidarité au combat et la cohésion du groupe.
Limos (Λιμός) – La Faim

Limos est la personnification de la faim et de la privation, centrales dans l’agôgè.
Dans l’éducation spartiate, les jeunes étaient soumis à des restrictions alimentaires pour forger leur endurance. Limos symbolise donc une maîtrise de soi et un entraînement à la résistance, faisant de la faim un allié plutôt qu’une faiblesse.
Thanatos (Θάνατος) – La Mort

Incarnation de la mort, Thanatos est intégré dans les rites funéraires et la culture martiale. L’acceptation de la mort était un élément essentiel de la mentalité spartiate. Dès siècles après, c’est pour cette raison que Gemistos Plethon valorisera l’immortalité de l’âme et des éléments de la Vertu (Arété).
Mourir au combat était glorifié, et Thanatos servait à rappeler que la vie était subordonnée à l’honneur et à la cité.
Hypnos (Ὕπνος) – Le Sommeil (lié à la Prophétie)

Hypnos, bien que déjà connu dans la mythologie grecque, prend une dimension particulière à Sparte où il est lié à la divination et aux rêves prophétiques.
Certains sanctuaires et temples permettaient aux Spartiates de recevoir des songes divins avant les campagnes militaires. Le sommeil était perçu comme une forme de communication avec les dieux.
Gelos (Γέλως) – Le Rire

Le rire spartiate n’est pas un rire débridé, mais un instrument de camaraderie. L’humour était pratiqué dans l’armée pour renforcer les liens entre guerriers et alléger les tensions.
Il existait des rituels où le rire servait à exprimer la supériorité des Spartiates sur leurs ennemis vaincus.
Aidos (Αἰδώς) – La Pudeur (liée à la honte et à l’honneur)
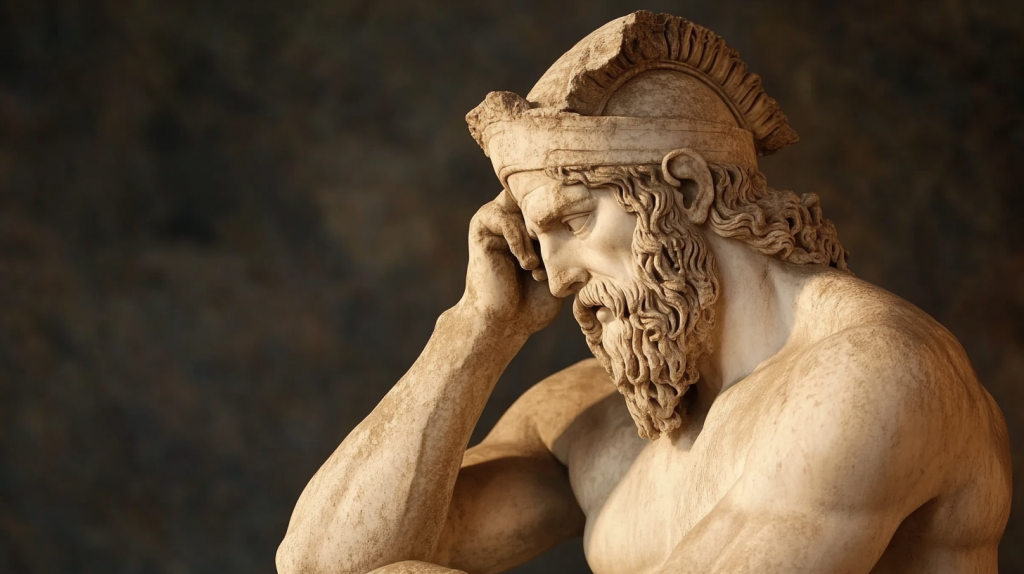
Aidos est la personnification de la pudeur, en lien avec la honte, mais aussi avec le respect et de l’honneur, essentiels à la morale spartiate.
Pausanias (Livre 3.17.4) et Plutarque (Vie de Cléomène, 9) en parlent comme d’un élément fondamental de l’éducation.
Aidos était inculqué dès l’enfance pour forcer les Spartiates à se conformer aux valeurs collectives. La honte d’une action lâche ou déshonorante était considérée comme pire que la mort.
La maitrise de soi au service de la cité

Les états physiques liés aux divinité du domaine de la maitrise de soi font aujourd’hui l’objet de chapitres dans des ouvrages sur la santé et le développement personnel, avec l’esprit individualiste qui caractérise notre époque. Mais dans le contexte de la cité de Sparte, c’est avant tout dans le service à la cité qu’il faut considérer la maîtrise de soi.
Comme l’écrit Nicolas Richer, ces sept divinités ont permettent « d’avoir en partage la tempérance, la sophrosiné (σωφροσύνη, tempérance/maitrise de soi), laquelle selon Platon2 consiste de la vie unanime en la domination sur les voluptés et les désirs3 ».
La maitrise de soi divine chez Platon
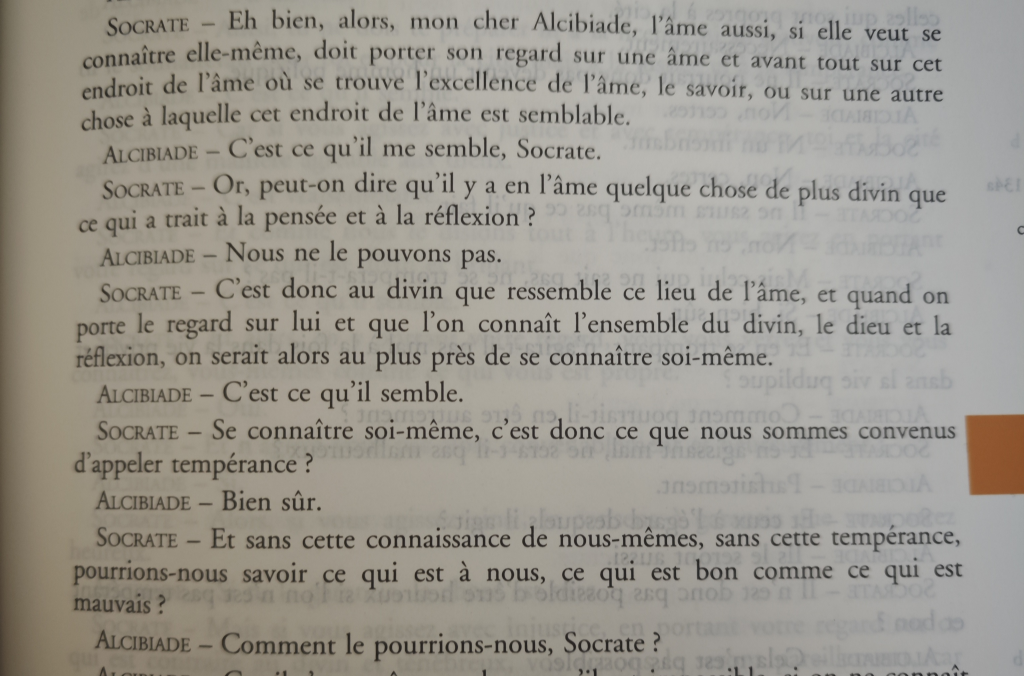
Platon associe la maîtrise de soi à la connaissance de soi.4 La σωφροσύνη (maitrise de soi) est généralement traduite par « tempérance » dans les œuvres de Platon en français. Le dialogue d’Alcibiade permet à Platon de lier la maitrise de soi, la connaissance de soi, et la piété (voir ci-contre).
Dans le Phèdre5, Platon défend « un mode de vie réglé et qui aspire au savoir. (…) Bienheureuse et harmonieuse est l’existence qu’ils passent ici bas, eux qui sont maîtres d’eux mêmes et réglés dans leur conduite, eux qui ont réduit en esclavage ce qui fait naître le vice dans l’âme et qui ont libéré ce qui produit la vertu. »
Dans Les Lois, Platon retranscrit La proposition de l’Étranger d’Athènes, un protagonistes du dialogue, visant à dompter les désirs au moyen d’une loi religieuse, « de cette façon, pour cette loi, il aura créé la stabilité la plus assurée6 », déclare l’Étranger d’Athènes. La Vertu est inséparable des Dieux. Le fruit philosophique de Platon est envisagé dans Les Lois, l’un de ses derniers ouvrages, comme l’objet d’un culte civique.
Références
- Nicolas Richer. La religion des Spartiates. Les Belles Lettres. Page 49 ↩︎
- Platon. Banquet. 196C ↩︎
- Nicolas Richer. La religion des Spartiates. Les Belles Lettres. Pages 100/101 ↩︎
- Platon. Alcibiade. 133D. Page 39 de l’édition Flammarion des Œuvres complètes ↩︎
- Platon.Phèdre. 256B ↩︎
- Platon. Les Lois, 838E ↩︎