|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Introduction
La théorie des Formes (ou Idées) est l’un des piliers fondamentaux de la pensée de Platon (427-347 av. J.-C.). Elle occupe une place centrale dans son œuvre philosophique et métaphysique, influençant profondément la tradition philosophique occidentale. Depuis quelques années on préfère parler de théorie des Idées parce que le terme «Forme» renvoi à une matérialité qui fait penser à l’inverse du sens que l’on veut lui donner.
Cette théorie philosophique helléniste a toute sa place en théologie «polythéiste». Elle vise à expliquer la nature de la réalité, de la connaissance et de la vérité en distinguant deux niveaux d’existence :
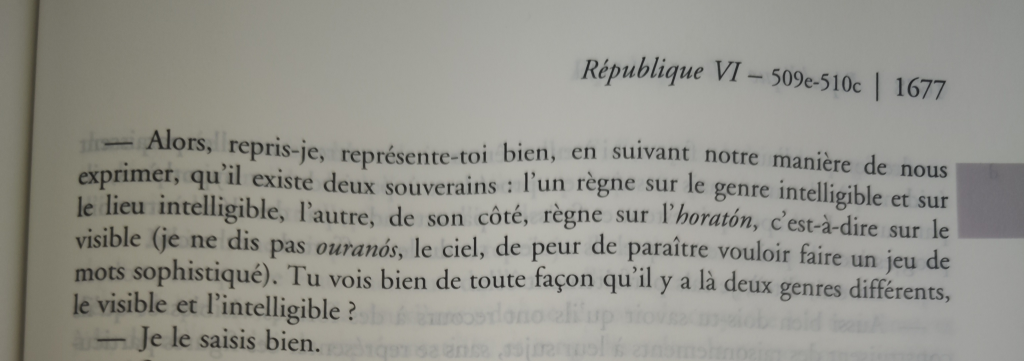
- Le monde sensible : celui que nous percevons avec nos sens ; dont les éléments sont changeants, imparfaits et éphémères.
- Le monde intelligible : celui des Formes/Idées; monde éternel, immuable et accessible uniquement par la raison.
Cette distinction est exprimée très clairement dans plusieurs dialogues par exemple au livre 6 de la République1 (voir image ci-contre). Platon postule que notre monde sensible n’est qu’une ombre imparfaite d’un monde supérieur : celui des Formes, des réalités immuables et parfaites. Cette théorie, largement développée dans La République, Phédon, Ménon et Parménide, a influencé toute la tradition philosophique occidentale, de l’Antiquité à nos jours.
Contexte et origine
1. Héritage philosophique et influences
Platon s’inscrit dans la tradition philosophique grecque, héritant des réflexions de ses prédécesseurs :
- Héraclite (vers 535-475 av. J.-C.) affirme que « tout change » (πάντα ῥεῖ panta rhei). Le monde sensible est en perpétuelle transformation, ce qui rend la connaissance stable impossible. « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. »
- Parménide (vers 515-450 av. J.-C.), au contraire, soutient que l’Être est unique, immobile et immuable, et que les apparences du changement sont illusoires. Le dialogue du Parménide de Platon a son importance dans le développement et la critique de la théorie des Formes.
- Socrate, maître de Platon, introduit la méthode dialectique et le questionnement sur les définitions universelles (Qu’est-ce que la justice ? Qu’est-ce que la beauté ?) conduisant à la théorie des Formes (la Justice en soi avec un grand J, la Beauté en soi avec un grand B).
Platon cherche à concilier ces visions en proposant que seule la connaissance des réalités immuables, c’est-à-dire des Formes, est possible.
Définition
Distinction entre monde sensible et monde intelligible

Platon affirme que le monde que nous percevons avec nos sens est une copie imparfaite d’un monde supérieur, celui des Formes ou Idées (εἶδος, ἰδέα).
Les dialogues de Platon considérés ensemble permettent de concevoir un soleil (le Bien suprême) éclairant des Formes (intelligibles) exposant des ombres (le monde sensible). Ainsi, ce que nous percevons n’est qu’une ombre, une image d’une réalité plus pure et parfaite.
La Forme comme modèle ontologique

Chaque objet du monde sensible est une copie imparfaite d’une Forme parfaite qui lui correspond. Par exemple :
- Une chaise sensible participe à la Forme idéale de la Chaise.
- Un cheval particulier participe à la Forme du Cheval.
- Un acte juste participe à la Forme du Juste.
La Forme est donc un modèle ontologique, une essence immuable et éternelle.
La théorie devient plus complexe lorsqu’il est avancé que une même réalité du monde sensible peut avoir pour essence plusieurs Formes.
Une illustration est donnée dans le dialogue du Parménide lorsque Socrate déclare2 qu’il y a une Forme en soi de la Ressemblance ainsi qu’une Forme de la Dissemblance, qu’une même chose du monde sensible peut participer à la fois à la Ressemblance en tant que chose semblable et à la Dissemblance en tant que chose dissemblable.
Les caractéristiques des Formes
Platon définit plusieurs propriétés essentielles des Formes :
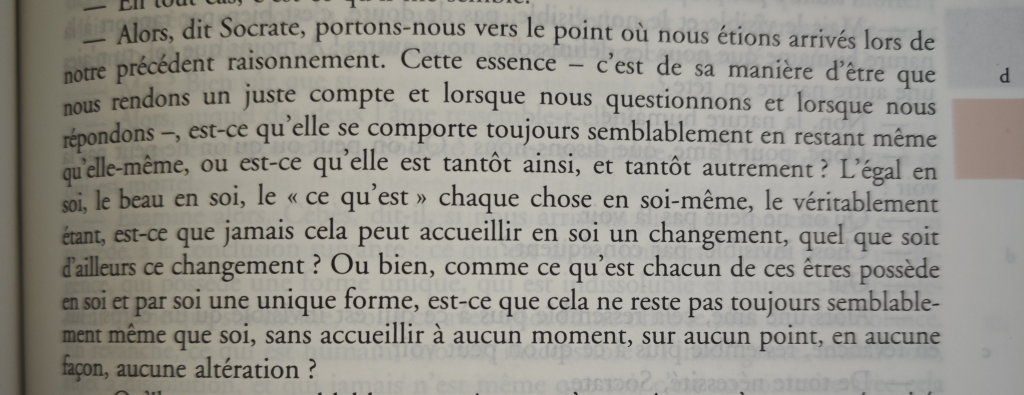
- Elles sont immuables : elles ne changent jamais, contrairement aux objets sensibles.
- Elles sont universelles : une Forme unique s’applique à de multiples objets particuliers.
- Elles sont indépendantes : elles existent en elles-mêmes, indépendamment de l’expérience humaine.
- Elles sont parfaites : elles incarnent l’essence pure de chaque chose.
- Elles sont transcendantes : elles existent indépendamment du monde physique.
Platon exprime cette idée dans Phédon3, décrivant le Beau en soi et ses caractéristiques.
Illustrations
Platon développe sa théorie dans plusieurs dialogues, chacun mettant en lumière un aspect spécifique.
Le mythe de la caverne (République, VII, 514a-520a)
L’un des passages les plus célèbres illustrant la théorie des Formes est le mythe de la caverne.
Résumé :
- Des prisonniers vivent enchaînés et la tête bloquée dans une caverne, ne voyant que des ombres d’objets (hors de leur champ de vision) projetées sur un mur par un feu situé derrière eux.
- Un prisonnier est libéré, monte à la surface et découvre la vraie réalité, illuminée par le Soleil.
- Lorsqu’il revient dans la caverne pour raconter la vérité aux autres, ils ne le croient pas.
Interprétation :
- La caverne représente le monde sensible, les ombres étant les objets perçus.
- La sortie vers la lumière symbolise l’ascension vers le monde des Formes, par la philosophie.
- Le Soleil représente la Forme suprême : le Bien (ou l’Un, selon les développements hellénistes postérieurs que nous avons déjà évoqué4).
Platon écrit dans la République5 que « [dans le monde intelligible], la Forme du Bien (…) une fois qu’on l’a vue, on doit en conclure que c’est elle qui constitue en fait pour pour toutes choses la cause de tout ce qui est droit et beau. »
Ce passage très important fait écho aux écrits de Plotinos, jusqu’à ceux de Georgios Gemistos Plethon qui décrivait Zeus «principe de toutes choses»6 avec des caractéristiques qui ressemblent au Bien de Platon tout en lui donnant aussi des caractéristiques de l’Être et de l’Intellect.
La ligne divisée (République, VI, 509d-511e)
Platon propose une division du réel en quatre niveaux :
- Imagination (εἰκασία) : illusions et reflets (ombres, reflets dans l’eau).
- Croyance (πίστις) : objets physiques, opinions sur le monde sensible.
- Pensée discursive (διάνοια) : raisonnements mathématiques, connaissance partielle.
- Intelligence pure (νόησις) : compréhension directe des Formes, accès à la vérité.
Ce schéma illustre le chemin de l’âme vers la connaissance véritable.
3. La théorie de la réminiscence (Ménon, 81c-86b ; Phédon, 72e-76e)
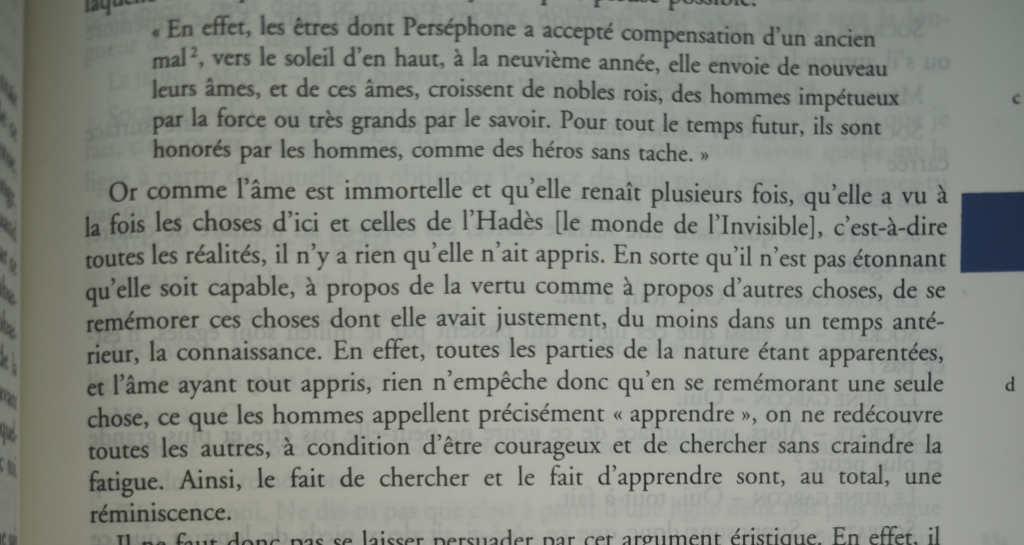
Platon soutient que l’âme a déjà connu les Formes avant de s’incarner. L’apprentissage est donc une réminiscence (ἀνάμνησις). Il écrit dans Ménon7 que l’âme, étant immortelle et ayant déjà vu toutes choses, connaît tout ; ainsi, il est naturel qu’elle puisse, en se ressouvenant, retrouver ce qu’elle sait (voir ci-contre).
Dans le Phédon8, Platon remarque que nous connaissons l’idée de l’égalité en soi mais que l’égalité parfaite n’existe pas dans notre monde. Par conséquent cela relèverait d’une connaissance que nous avons eu et dont nous avons été dépossédés. La démonstration de la théorie de la réminiscence est donc liée à la théorie des Formes.
Conséquences philosophiques et critiques
Au delà des écrits de Platon la théorie des Formes constitue la base d’une très importante production théologique hellénique, et même ensuite abrahamique. Les idées de Platon ont parfois entraîné la méfiance des musulmans et des chrétiens du fait que le monde intelligible peut être considéré comme étant le monde des Dieux où la multiplicité est une évidence. Cependant, la théorie des formes va aussi avoir une influence sur les religions islamiques et chrétiennes.
Néoplatonisme
La théorie des Formes est l’un des fondements du néoplatonisme. Sans cette théorie, le néoplatonisme aurait été radicalement différent. La triade de Plotinos fait écho au mythe de la caverne et à la distinction entre le sensible et l’intelligible transcendé par une lumière (l’Un).
Les développements théologiques formulés notamment par Proklos s’inscrivent dans un univers correspondant à la théorie des formes, Tout en complexifiant et enrichissant cette conception du monde. L’enrichissement de la théorie des Formes se retrouve dans notamment dans les commentaires du Parménide réalisés par les auteurs néoplatoniciens successifs. Les commentaires du Parménide méritent des développements à part.
Chrétienté
Saint Augustin (354-430), fortement influencé par le néoplatonisme, adapte la théorie des Formes au christianisme en identifiant les Formes aux Idées divines dans l’intellect de Dieu. Il défend l’idée que la Vérité absolue et immuable réside en Dieu, et que le monde sensible en est une ombre imparfaite, en écho à l’Allégorie de la caverne.
Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) intègre la pensée platonicienne via Aristote. Il interprète les Formes comme des modèles existant dans l’intellect divin, mais considère que leur actualisation dans le monde sensible ne se fait pas par imitation mais par causalité divine.
Les mystiques chrétiens, comme Maître Eckhart, développent une vision où la contemplation des Formes devient une manière de s’unir à Dieu, ce qui fait écho à la théorie des Formes mais aussi aux pratiques recommandées par les néo-platoniciens.
Islam
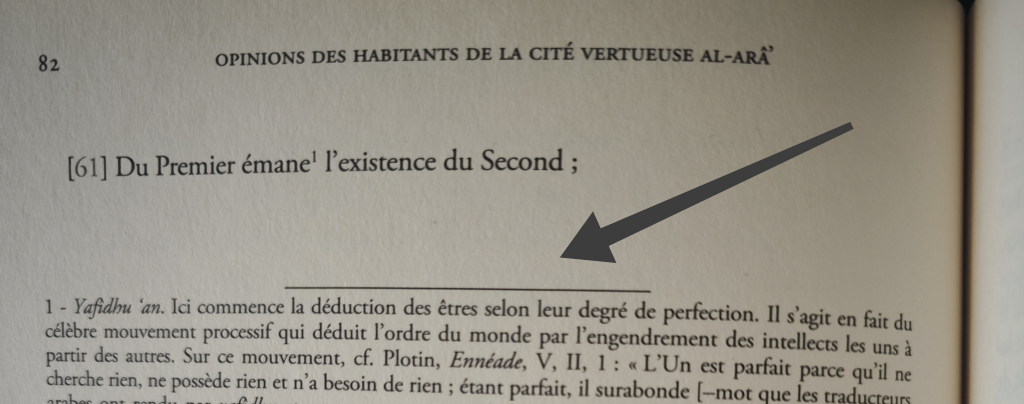
Al-Fârâbî (872-950), qui combine la théorie des Formes avec la vision aristotélicienne et voit en Dieu le Premier Intellect, source des Idées. Il est le successeur d’Al-Kindi (801-873), qui avait introduit des éléments de la pensée néoplatonicienne dans l’islam). Farabi est l’auteur d’un ouvrage inspiré de la République intitulé Opinions des habitants de la cité vertueuse.
Avicenne (Ibn Sina, 980-1037), qui développe une métaphysique où les essences (Formes) existent en Dieu avant d’être manifestées dans le monde.
Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198), qui critique l’interprétation néoplatonicienne et insiste sur la réalité de la matière comme substrat nécessaire aux Formes.
Critiques de la théorie
Métaphysique d’Aristote
Aristote9 critique la séparation entre le monde sensible et les Formes, affirmant que les essences doivent être immanentes aux choses et que la théorie des formes serait inutile au monde sensible. Il reproche à Platon de doubler inutilement la réalité en postulant un second monde au lieu d’expliquer directement le monde sensible.
Aristote ne comprend pas la théorie des Formes de Platon à proprement parler. Il propose une autre philosophie, que des auteurs comme Pléthon proposent de subordonner à celle de Platon, estimant ce dernier supérieur.
Parménide cité par Platon
La première partie du dialogue de Parménide est une critique de la théorie des Formes.
L’un des arguments les plus célèbres soulevés par Parménide est le cas du paradoxe du troisième homme, où une nouvelle Forme est toujours nécessaire pour relier les Formes existantes aux objets sensibles. Si des homme différents sont reliés à une Forme, alors n’y a-t-il pas nécessairement un point commun constituée par une Forme intermédiaire faisant le lien ? Si oui, le principe se répète en une digression infinie.
Parménide remet en question la séparation entre les Formes et le monde sensible. Si les Formes sont transcendantes et existent indépendamment du monde sensible, comment les objets sensibles peuvent-ils y participer, demande Parménide ?
Troisième objection de Parménide, si les Formes sont complètement séparées du monde sensible, comment pouvons-nous les connaître ?
La quatrième remarque de Parménide porte sur la séparation des Formes entre elles, Si l’Idée de la Justice et l’Idée du Beau sont totalement séparées, comment peuvent-elles s’accorder pour créer une réalité sensible belle et juste ?
La dernière objection de Parménide concerne l’application des Formes à toute réalité sensible. Si la théorie des Formes ne peut pas être appliquée de manière cohérente à toutes les catégories d’objets, alors elle est arbitraire et incomplète.
Conclusion
La théorie des Formes de Platon constitue une des tentatives les plus ambitieuses de répondre aux grandes questions de la métaphysique.
Références
- Platon. République. 509d ↩︎
- Platon. Parménide. 129a ↩︎
- Platon. Phédon. 78d ↩︎
- https://plethon.fr/2025/01/26/lun-lintellect-et-lame/ ↩︎
- Platon. République. 517c ↩︎
- https://plethon.fr/2025/02/02/introduction-a-loeuvre-de-georgios-gemistos-plethon/ ↩︎
- Platon. Ménon. 81c-d ↩︎
- Platon. Phédon. 74a-b ↩︎
- Aristote. Métaphysique. A, 9, 990b-991b ↩︎